
Réflexions sur les enjeux du développement
- Biographie »
- Conférences »
- Activité minière et l’avenir 8ii13
- Association humaniste du Québec
- Bioproduits ou Economic Conditions, Political Decisions, Environmental Losses – pour NRCan, juillet 2009
- Calculation of Quebec’s GPI à Beijing
- Conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge, 26 mars 2015
- Conseil régional de l’environnement de Montréal, le 13 janvier 2016
- CSN janvier 2012
- Défaillances de systèmes
- Dérives énergétiques et métalliques (GRIP-UQAM le 4 mai 2013)
- Développement durable, trop tard – Analyse stratégique, sans mandat (BAPE, le 8 avril 2013)
- Développement durable: trop tard
- Échec d’une carrière, échec d’une société – Université de Sherbrooke 28 janvier 2014
- Économie verte ou effondrement? CERIUM le 25 juin 2015
- ÉNAP-CREXE à ACFAS Évaluation de programmes 8 mai 2012
- Festival de la décroissance conviviale du 1er juin 2019
- GIRAM le 24 mars 2019 – Le troisième lien
- HEC Pour la suite du monde 18-19v09
- IPV Outil pour l’indignation UQAR/CREBSL 24 février 2012
- IRDA International Congress Biosystems Engineering 16 juin 2010
- L’effondrement: fin d’un monde. construire un nouveau? – Fin de semaine du 7-8 septembre 2019
- L’IPV présenté au CASS à Beijing 28×11
- La sortie du pétrole – plus que l’on pense: il n’y aura pas de transition
- Le monde dans lequel nous vivrons: scénario du pire – Juges de la Cour du Québec le 25 mai 2006
- Le Québec face à une transition
- Les dérapages du Plan Nord à l’AMEUS 2 mars 2012
- Oeillères cognitives dans l’administration publique – Observatoire de l’administration publique de l’ÉNAP le 27 septembre 2013
- Ordre des ingénieurs forestiers le 20 mars 2013
- Présentation au Centre des arts actuels Skol le 3 novembre 2018
- ROEÉ: Regroupement des organismes environnementaux en énergie – le 22 octobre 2013
- Simplicité involontaire le 27 octobre 2018
- Sortir du pétrole
- Trop tard pour éviter l’effondrement? UL 11 février 2013
- Écrits »
- Appel aux groupes concernant l’économie verte (août 2012)
- Brundtland: Sa vision était claire
- Conférence des juristes et Loi sur le développement durable (2009)
- Démographie, en Chine et au Québec
- Développement minier dans la deuxième moitié de l’ère des métaux
- Échec du mouvement environnemental
- Échec du mouvement social
- Économie biophysique: pour sortir du désastre
- En finir avec l’illusion de la croissance novembre 2011
- Humanisme et l’environnement: la grande conversation
- L’administration publique: Œillères cognitives et risques d’illusion dans la pratique, dans la recherche et dans la vérification
- L’automobile, électrique ou pas: fausse bonne idée? fuite en avant? passage obligé?
- L’OCDE fonce dans la croissance verte pour Rio+20, et l’IRÉC le suit
- La Banque mondiale et le développement
- Les crises et le développement (mars 2009)
- Les indignés sans projets? – des pistes pour le Québec
- Life Report
- Limites à la croissance
- Mouches »
- Philosophe écologiste errant
- Remplacer quelle génération?
- Trop tard, pace David Suzuki
- Université de Sherbrooke – économie de l’environnement 970
- Galerie nature »
- Galerie rurale »
- Galerie urbaine »
- Général »
- Indice de progrès véritable (IPV) »
- #1607 (pas de titre)
- A consensus that the GDP is not a good indicator of our progress?
- Franc-Nord Franc-Vert
- Genuine Progress Indicator USA (2006)
- IPV Chapitre 2: Foresterie
- IPV Introduction
- IPV Synthèse
- L’IPV dans l’évaluation de programme (ÉNAP-CREXE mai 2012)
- La recherche, la pratique et la vérification: un rôle pour l’IPV (OAP/ÉNAP septembre 2013)
- Livre sur l’IPV: Compte-rendu et couverture
- Some methodological issues concerning the GPI for Quebec 2013
- Trop tard : Suivi et couverture médiatique »
- Blogue
- Biographie »
- Conférences »
- Activité minière et l’avenir 8ii13
- Association humaniste du Québec
- Bioproduits ou Economic Conditions, Political Decisions, Environmental Losses – pour NRCan, juillet 2009
- Calculation of Quebec’s GPI à Beijing
- Conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge, 26 mars 2015
- Conseil régional de l’environnement de Montréal, le 13 janvier 2016
- CSN janvier 2012
- Défaillances de systèmes
- Dérives énergétiques et métalliques (GRIP-UQAM le 4 mai 2013)
- Développement durable, trop tard – Analyse stratégique, sans mandat (BAPE, le 8 avril 2013)
- Développement durable: trop tard
- Échec d’une carrière, échec d’une société – Université de Sherbrooke 28 janvier 2014
- Économie verte ou effondrement? CERIUM le 25 juin 2015
- ÉNAP-CREXE à ACFAS Évaluation de programmes 8 mai 2012
- Festival de la décroissance conviviale du 1er juin 2019
- GIRAM le 24 mars 2019 – Le troisième lien
- HEC Pour la suite du monde 18-19v09
- IPV Outil pour l’indignation UQAR/CREBSL 24 février 2012
- IRDA International Congress Biosystems Engineering 16 juin 2010
- L’effondrement: fin d’un monde. construire un nouveau? – Fin de semaine du 7-8 septembre 2019
- L’IPV présenté au CASS à Beijing 28×11
- La sortie du pétrole – plus que l’on pense: il n’y aura pas de transition
- Le monde dans lequel nous vivrons: scénario du pire – Juges de la Cour du Québec le 25 mai 2006
- Le Québec face à une transition
- Les dérapages du Plan Nord à l’AMEUS 2 mars 2012
- Oeillères cognitives dans l’administration publique – Observatoire de l’administration publique de l’ÉNAP le 27 septembre 2013
- Ordre des ingénieurs forestiers le 20 mars 2013
- Présentation au Centre des arts actuels Skol le 3 novembre 2018
- ROEÉ: Regroupement des organismes environnementaux en énergie – le 22 octobre 2013
- Simplicité involontaire le 27 octobre 2018
- Sortir du pétrole
- Trop tard pour éviter l’effondrement? UL 11 février 2013
- Écrits »
- Appel aux groupes concernant l’économie verte (août 2012)
- Brundtland: Sa vision était claire
- Conférence des juristes et Loi sur le développement durable (2009)
- Démographie, en Chine et au Québec
- Développement minier dans la deuxième moitié de l’ère des métaux
- Échec du mouvement environnemental
- Échec du mouvement social
- Économie biophysique: pour sortir du désastre
- En finir avec l’illusion de la croissance novembre 2011
- Humanisme et l’environnement: la grande conversation
- L’administration publique: Œillères cognitives et risques d’illusion dans la pratique, dans la recherche et dans la vérification
- L’automobile, électrique ou pas: fausse bonne idée? fuite en avant? passage obligé?
- L’OCDE fonce dans la croissance verte pour Rio+20, et l’IRÉC le suit
- La Banque mondiale et le développement
- Les crises et le développement (mars 2009)
- Les indignés sans projets? – des pistes pour le Québec
- Life Report
- Limites à la croissance
- Mouches »
- Philosophe écologiste errant
- Remplacer quelle génération?
- Trop tard, pace David Suzuki
- Université de Sherbrooke – économie de l’environnement 970
- Galerie nature »
- Galerie rurale »
- Galerie urbaine »
- Général »
- Indice de progrès véritable (IPV) »
- #1607 (pas de titre)
- A consensus that the GDP is not a good indicator of our progress?
- Franc-Nord Franc-Vert
- Genuine Progress Indicator USA (2006)
- IPV Chapitre 2: Foresterie
- IPV Introduction
- IPV Synthèse
- L’IPV dans l’évaluation de programme (ÉNAP-CREXE mai 2012)
- La recherche, la pratique et la vérification: un rôle pour l’IPV (OAP/ÉNAP septembre 2013)
- Livre sur l’IPV: Compte-rendu et couverture
- Some methodological issues concerning the GPI for Quebec 2013
- Trop tard : Suivi et couverture médiatique »
- Blogue
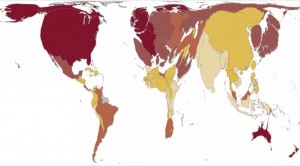


Bonjour,
vos critiques de l’absence de la notion de limite (et de l’hégémonie de son contraire, la croissance infinie) parmi les économistes hétérodoxes m’a incité à chercher parmi mes signets.
Je lis avec fidélité quelques blogeurs macro-économistes, excluant la vaillante Gail Tverberg, qui n’est qu’actuaire (blague).
J’ai trouvé ce billet, où discutent justement entre eux ces économistes (Matias Vernengo et J.W. Mason) sur la question de la croissance: « A farewell to growth? »
http://www.nakedkeynesianism.blogspot.ca/2012/02/farewell-to-growth.html
Je note cependant que Vernengo ne croît pas trop à l’amenuisement proche des ressources mais est plutôt préoccupé par le réchauffement global et son impact sur la croissance.
Commentaire
Disons que je n’ai pas beaucoup de patience avec des interventions du type de Vernengo ici qui jouent dans les généralités pour aborder les défis inscrits dans le travail du Club de Rome. Juger ses auteurs comme malthusiens ne va nulle part, mais implique tout simplement un point de départ, une insistence sur un certain optimisme comme préjugé.
Ce qui est intéressant dans les enjeux associés à la COP21 est la présence, pour une rare fois, d’un élément quantitatif pour ce qui est des limites. Le GIÉC nous a fourni un calcul du budget carbone qu’il faut respecter pour éviter un réchauffement au-dela de 2 degrés, et les participants doivent essayer d’en tenir compte, sinon l’esquiver. Les travaux du DDPP à cet égard – cf. mes deux derniers articles – deviennent assez percutants face à l’ensemble des débats sur la croissance et les changements climatiques: En voulant maintenir la croissance tout en respectant le budget carbone, ils échouent. Il nous faut voir comment aborder, dans le détail, le retrait du pétrole en ce qui a trait à ses implications pour le modèle économique tel que mis en oeuvre dans les différents pays. C’est clairement une décroissance qui est en cause, mais évite le mot qui est sujet de critique par des généralités aussi. L’entrevue de Gaël Giraud suggérée par Thérèse Lavoie rentre là-dedans de façon intéressante; un pendant de son argument est celui partant des analyses de l’ÉROI des différents types d’énergie. Voir pour l’ensemble L’Illusion financière de Giraud, de 2013.
Merci pour ce billet M. Mead et merci de nous rappeler encore une fois que nous faisons partie des privilégiés sur cette planète et qu’il faudra bien un jour s’en rendre compte.
M. Lutz, si vous avez absolument besoin qu’un diplôme officiel d’économiste ait été décerné à quelqu’un pour considérer sa crédibilité, je vous invite à consulter celui-ci:http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/04/19/gael-giraud-du-cnrs-le-vrai-role-de-lenergie-va-obliger-les-economistes-a-changer-de-dogme/
La raréfaction des ressources fossiles aura un impact, il ne faut pas en douter. En tous cas, cet économiste reconnait l’importance de l’effet de levier qu’ont eu les énergies fossiles. Il est le traducteur du livre « L’imposture économique » de Steve Keen.
« M. Lutz, si vous avez absolument besoin qu’un diplôme officiel d’économiste ait été décerné à quelqu’un pour considérer sa crédibilité »
Mais non! Pas du tout! vous n’avez pas lu ma parenthèse? J’étais ironique.
Mais M.Mead mentionnait les économistes hétérodoxes et G.Tverberg n’en est pas une, malgré l’excellence et la pertinence des ses analyses.
Et au contraire, les personnes qui s’expriment le plus justement sur la « science économique » sont majoritairement des personnes qui ne sont pas issues de ces milieux, donc, précisément, PAS DES ÉCONOMISTES.
Contemporains: Frédéric Lordon, Paul Jorion, Gillian Tett, Gail Tverberg
Historiques: John Maynard Keynes (mathématicien), Karl Marx (philosophe)
Je suis toujours surpris de lire des économistes qui semblent capables de mettre en question le modèle et les propositions omniprésentes qui en découlent. Giraud semble en être un, et François Morin, que je viens de découvrir, semble en être un autre. Je soupçonne qu’ils ne font pas partie des économistes atterrés en France, l’équivalent de nos économistes hétérodoxes. Je ne veux pas dénigrer ces derniers, mais souligner leur manque de perspective adéquate. Frédéric lordon, que vous mentionnez en suggérant qu’il n’est pas économiste, semble en être un troisième.
Frédéric Lordon est un cas intéressant, de ses propres mots: « je ne sais plus ce que je suis. Économiste devenu philosophe, philosophe anciennement économiste, c’est compliqué ces histoires d’identité disciplinaires. »
Pour ce qui est de Vernengo, je suggérais plutôt le billet pour les répliques de JW Mason, il était en désaccord (et effaça même un commentaire qu’il jugeait trop grossier).
Mason est une pointure, je lis scrupuleusement chacun de ses billets, dans les mesures de mes connaissances. Il se décrit ainsi: « My politics comes mostly from Marx. My economics comes mostly from Keynes. »
un de ses textes importants est « disgorge the cash » à propos de l’effet de l’actionnariat sur le capital des corporations.
http://jwmason.org/the-slack-wire/