Le rôle du Pacte: contribution non sollicité d’un lecteur
Publié par Harvey Mead le 9 Mar 2019 dans Blogue | 14 commentaires
Ce long texte réfléchi a été soumis en commentaire sur mon récent article sur mon propos à l’effet qu’il y a nécessité de préciser ce qui est impliqué dans l’espoir de pouvoir «gérer» le défi des changements climatique. Il couvre tellement de sujets pertinents au débat que je pense qu’il mérite place ici comme un article à part, plutôt comme commentaire. L’auteur est Gilles Gagné, professeur de sociologie à l’Université Laval. J’y reviendrai avec mes propres réflexions sur le texte d’ici quelques jours.
Cher Harvey Mead,
Je voudrais faire une observation en passant sur le jugement suivant qui se trouve au début de votre texte «A corriger : l’absence d’un portrait face aux défis définis par le GIÉC».
Vous dites ce qui suit :
La mobilisation récente autour du Pacte de Dominique Champagne et de la Déclaration d’urgence climatique (DUC) se fait presque en abstraction des chiffres définissant les défis. C’est certainement le cas pour le Pacte, et le projet de loi conçu et diffusé dans les derniers mois par deux avocats de la société civile, une sorte de concrétisation du Pacte, propose d’encadrer des gestes du gouvernement en partant des engagements de ce dernier, beaucoup trop faibles pour répondre à presque quoi que ce soit.
Bien que j’aie le plus grand respect pour vos travaux, que je sois un lecteur assidu de vos chroniques et que j’incline à penser que vous avez raison sur pratiquement toute la ligne, je suis déçu (mais je peux comprendre) que vous n’ayez pas compris la dimension rhétorique du «Pacte de Dominic Champagne» et que vous lui appliquiez le coup de pied de l’âne après que tous les négationnistes de la province du «troisième lien» l’aient dénoncé au prétexte qu’il y avait dans les signataires une demie douzaine de personnes qui gagnaient plus qu’eux-mêmes.
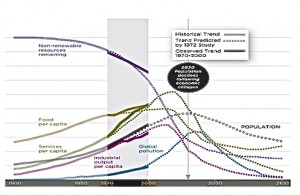
La question fondamentale semble être de savoir si les projections des informaticiens de Halte à la croissance (la figure), comme celles des scientifiques (et autres) du GIÉC, identifient bien l’échéance, aux alentours de 2025…
Les anciens tenaient la rhétorique pour le plus grand de tous les arts, celui qui fédère la logique, la grammaire, l’image, le nombre, la beauté et l’éloquence, et ils la respectaient parce qu’ils tenaient l’effort de convaincre ses concitoyens comme une alternative honorable à la guerre civile. Or, c’est bien de cela qu’il s’agit, la guerre civile, celle qui se prépare dans le refus catégorique de préparer par des mesures systématiques de justice sociale les effondrements qui s’en viennent. Je suis signataire du Pacte mais je vous rassure: je n’irai pas déposer les trois quarts de mes revenus dans la boite postale du ministère pour qu’il les redistribue aux moins fortunés et finance ainsi la réduction des écarts de consommation que nous devrons organiser pour rester civilisés. D’ailleurs personne ne le fera, je peux vous le garantir. Nous n’avons, pour faire face à ce qui nous tombera dessus et pour mettre en place les partages qui seront la seule alternative aux violences, qu’un seul instrument et c’est celui qui oblige, qui interdit, qui permet ou qui garantit – en bref: la loi. Et bien que cet instrument s’épuise à chaque jour qui passe à promettre la lune à tout le monde (tout en mettant de l’argent dans la poche des Québécois), il restera en état de fonctionner raisonnablement tant que nous serons assez nombreux à croire en lui.
Or, le Pacte est justement une demande collective adressée à l’État par plus de 260 000 citoyens et citoyennes afin qu’il place la question écologique au principe de son action. L’engagement à faire des efforts individuels spontanés se présente dans ce Pacte comme la justification de la demande d’action législative, et comme indication de la «disposition subjective» à s’y astreindre, nullement comme la pièce maîtresse de notre avenir. Cet appel à la «moralité objective» et au débat législatif, exceptionnel à notre époque de scepticisme généralisé à l’endroit des efforts de définir le bien commun, se réclame lui-même du fait que le problème fondamental posé par toute prise en compte de la dégradation environnementale est un problème de justice sociale. Toute réduction du niveau global de la consommation qui viendrait simplement de la rareté et des prix serait traduite presqu’automatiquement par le marché en un accroissement des inégalités, un accroissement qui peut rapidement tourner à la catastrophe, comme on en a vu l’amorce en France, si l’État lui-même entreprend d’appuyer par des taxes régressives la pression des prix sur les bas revenus. D’où la rhétorique «contractuelle» du Pacte qui met dans la bouche des signataires un engagement «à faire leur part», mais en contrepartie d’un engagement structurant de l’État à assurer la progressivité des efforts collectifs et le caractère systématique de ceux-ci.
Certes, on peut déplorer que le Pacte ne mette pas en lumière le fait que le capitalisme est incompatible avec toute forme de décroissance, qu’il ne donne pas de mesures chiffrées des défis ou des objectifs, qu’il fasse miroiter la possibilité d’une «transition durable» qui ne changerait rien ou qu’il en appelle à des «élus» dont la réélection est le seul horizon. On peut encore déplorer qu’il fasse focus sur le pétrole pendant que le glyphosate nous assassine. Et ainsi de suite. Mais le problème avec ces reproches c’est que le Pacte n’est pas une «solution», ni une feuille de route, ni le programme d’une révolution; c’est un effort de mobilisation démocratique fondé sur la conviction que l’action de l’État doit être repensée à la lumière de la crise environnementale.
Rien que ça, mais déjà ça. La croissance a été depuis deux siècles à la base de l’acceptabilité sociale des inégalités sociales parce qu’elle a rendu possible le relèvement, en valeurs absolues, du niveau de vie des plus pauvres. La fin de la croissance, qui viendra par des catastrophes ou par des décisions, poussera les sociétés capitalistes à refaire ce chemin dans le sens inverse et à réduire d’abord le niveau de consommation de ceux qui sont au bas de l’échelle. Et cette pression «marchande» aura des effets aussi bien à l’échelle des conflictualités globales qu’à celle des solidarités locales, accroissant les unes et réduisant les autres. Ni le marché, ni la charité, ni la technique, ni les religions, ni la science ne seront en mesure d’obvier par elles-mêmes à cette destruction du monde humain par les «dispositifs» qui nous gouvernent et c’est sur ce fait que prend appui le plaidoyer en faveur d’un reformatage du politique par les enjeux environnementaux.
Il y a dans votre appel à corriger le Pacte par des indications chiffrées concernant les menaces et les défis environnementaux une sorte de naïveté qui ne laisse rien à désirer à celle que vous reprochez vous-même au Pacte. Cette situation illustre bien le fait que nous nous débattons au milieu de contractions qui rendent réversibles la plupart de nos arguments, la lucidité de l’un devenant la naïveté de l’autre, et vice versa. Depuis que la science a entrepris de nous convaincre de la réalité du changement climatique par des données probantes, le scepticisme populaire à l’endroit des conséquences qu’elle en tire et des solutions qu’elle propose s’est accru plutôt que l’inverse. Cela tient en partie au fait que les effets inéluctables des dégradations environnementales accumulées, dont l’essentiel est à venir, ont le défaut, au présent, de tomber sur «d’autres» quand ils sont catastrophiques ou d’êtres tolérables quand ils tombent sur «nous». Mais, plus fondamentalement, ce scepticisme croissant tient au fait que la science parle maintenant des deux côtés de la bouche et qu’elle promet simultanément des miracles et des hécatombes. Car songez-y: comment faire oublier que c’est la «science» elle-même qui nous a mené là où nous sommes, d’abord en nous transportant du «monde clos vers l’univers infini», ensuite en enseignant que la puissance technique de l’humanité était, par définition, la solution aux problèmes qu’elle engendre. Quand vous parlez graphiques, équations, statistiques et indicateurs, toutes choses précieuses et nécessaires il va sans dire, vous parlez forcément comme si «la crise des sciences européennes» (Husserl) n’avait pas eu lieu et comme si tout le 20e siècle épistémologique n’avait pas été une longue réflexion critique sur la nature de cette science moderne qui promettait de nous faire maîtres et possesseurs de la nature. A tel point que l’idée de la vérité scientifique, accueillie d’abord comme forme universalisable du rapport au monde, nous est apparue récemment comme un archipel d’éclaircies locales rendues possibles par une civilisation plus prompte à plier le monde à ses besoins qu’à y trouver une raison de les limiter. La valeur contemplative de la connaissance scientifique moderne (l’Harmonices Mundi de Kepler), de même que son aptitude présumée à rassembler les esprits dans la vérité, ont été dénoncées par le tribunal de la puissance opératoire du 20e siècle comme étant des aspirations infantiles de la civilisation scientifique, si bien que c’est maintenant la simple capacité d’intervenir dans le monde d’une manière efficace qui sert de critère pour arbitrer la compétition des paradigmes qui s’arrachent les fonds de recherche.
Or, c’est précisément cette forme délirante – technoscientifique – de la science qui fait obstacle aux efforts de connaissance qui sont les vôtres. Pendant que l’on assomme le public avec les miracles inimaginables qu’il faudrait attendre du génie-génétique, de l’intelligence artificielle, des nanotechnologies et du numérique sous toutes ses formes, pendant que l’on presse les citoyens à faire confiance une fois de plus (et peut-être une fois de trop) à la capacité scientifique d’arracher à la planète, à la nature, au travail, à l’univers ou à l’esprit lui-même de quoi satisfaire tous les fantasmes, vous postulez de votre côté qu’une description scientifique plus précise de la fin de ce monde serait mieux en mesure d’en faire comprendre l’imminence! Comme si la science pouvait en même temps promettre le paradis sur terre et décrire avec précision l’enfer qui s’en vient pour appeler les damnés au repentir? Honnêtement, je suis prêt à espérer que vous avez raison mais je crains que nous n’en soyons plus là. De part et d’autre, c’est la science qui se dit et se dédit du même souffle, qui montre la corne d’abondance au bout de la prochaine innovation puis qui prouve que l’enfer se tient juste derrière la somme des gadgets. La technoscience est l’allié principal du capitalisme d’innovation et il est devenu grâce à cette alliance le parrain de nos institutions universitaires. Même les départements de «sciences» religieuses veulent leur part du financement destiné aux pratiques innovantes alors que la «science» économique veut mettre un prix sur la biodiversité, sans doute pour envoyer la facture aux chasseurs d’aurochs de la fin du Moyen-Âge. Voilà pourquoi, cher Harvey Mead, on distribue des prix scientifiques dans l’indifférence générale et voilà pourquoi le cynisme qui accueille l’attribution du Nobel de la paix à des va-t’en-guerre montre son nez quand on couronne de la même manière (c’est-à-dire avec l’argent d’un fabriquant d’armes) la chimie des plastiques, le génie génétique ou la rationalité économique de l’esclavage. L’épuisement de la croyance à l’égard des révélations scientifiques est une forme de désertification des esprits qui résulte de la surexploitation de la confiance du public; et la formation d’une planète du scepticisme (ou de la damnation assumée) fait partie de la crise écologique.
Tout cela revient à dire que la crise écologique, qui n’est pas tombée du ciel, jette une lumière accablante sur l’ensemble de notre civilisation, en commençant par le système économique qui en est devenu le moteur. Mais cela revient aussi à dire que nous n’avons pas le choix et que nous devons continuer à faire des distinctions avec les instruments mêmes qui tendent à les embrouiller; que nous devons, par exemple, distinguer dans notre avenir ce qui ne peut déjà plus être changé de ce qui pourrait encore l’être et choisir, parmi ce qui reste théoriquement possible, des objectifs réalistes au regard des ressorts pratiques (culturels, moraux, politiques et techniques) de l’action collective. Or, tout le problème se tient exactement là: qui peut prévoir de quoi il sera capable avant même de sortir de son ordinaire pour s’engager dans une entreprise inédite? La jeune femme qui a traversé l’Atlantique à la rame a commencé par «croire» que la chose lui était possible et c’est avec ce fragile appareillage «moral» qu’elle s’est jetée à la mer pour réapparaître, transformée par l’expérience, quatre mois plus tard à Lorient. Le passage à l’acte de ce qui est en puissance n’est pas une partie de Tic-Tac-Toe vouée à la nulle; et le possible reste une simple «possibilité» tant qu’une subjectivité ne s’y est pas investie. Voilà qui me ramène à votre jugement sur le Pacte: vous dites que la mesure législative qu’il propose est dérisoire et qu’elle serait «presque» parfaitement sans effet. On croirait presque ici que vous détenez déjà la preuve que le voyage est impossible. Alors que la proposition en question vise essentiellement à nous convaincre de mettre collectivement le pied à l’étrier, on dirait que vous savez déjà que ce brave Don Quichotte, «qui fait abstraction des chiffres», n’ira nulle part sur sa Rossinante approximative.
Le Pacte accorde pourtant à la science toute l’importance qu’il est possible de lui accorder sans la divorcer de l’expérience commune; il souligne de manière raisonnable le consensus des chercheurs et il invoque les faits qui accréditent d’ores et déjà les pronostics antérieurs. Maintenant que le commun des mortels peut lui-même faire l’expérience pratique des transformations que la théorie lui annonce depuis plusieurs décennies, le Pacte prend appui sur cette convergence entre les vérifications communes, d’une part, et l’échec des efforts de falsification des négationnistes, de l’autre, pour rappeler que le changement climatique (commençons par là) n’est plus une hypothèse et que le caractère dramatique de ses effets est avéré. Mais il refuse, et j’ai le sentiment que c’est ce que vous lui reprochez, de s’engager dans la recherche et l’exposé d’une solution technique globale. Il est clair, en effet, que le Pacte évite de s’engager vraiment sur la question de savoir si la fin est commencée, si le point de bascule est atteint, si les feedback galopants sont enclenchés, tout comme il est clair qu’il s’interdit d’en déduire les cheminements critiques, les calculs de tonnage, les échéanciers d’étape, les mesures de mitigation, le décompte des années, les innovations techniques et les changements de régime (alimentaires et politiques) qui devraient faire partie du méga-programme d’atténuation; il se contente de conforter l’un par l’autre les mesures factuelles les plus robustes et l’expérience communes et il évite de soulever contre lui l’alliance désastreuse du scepticisme scientifique ordinaire («toute proposition sur l’avenir a la forme d’une hypothèse, falsifiable mais non démontrable») et du fatalisme post-humain («la nature s’arrangera mieux sans êtres humains»). La crise écologique n’est pas un problème local dont les variables chiffrées pourraient être isolées par quelques majestueux ceteris paribus et rendu possible d’une solution qui aurait la forme d’une sorte de Gossplan soviétique. Elle est le fait d’un système (non-linéaire) dont l’évolution est déterminée mais non prévisible. Dans ce contexte de calculabilité limitée, nous devons certes garder l’œil sur toutes les choses incertaines qui ne deviennent certaines qu’avec le passage du temps, nous devons aussi éviter de placer dans les chiffres tous nos efforts de connaissance. L’action pratique est la mère de toutes les formes de l’apprentissage, la seule que la réflexion théorique puisse inspirer en en faisant la critique. Si nous voulons apprendre, et ne pas simplement être exposés à des enseignements qui se contredisent, il nous faut entrer dans l’action. Maintenant. Et cesser d’espérer qu’un gouvernement, un comité, une conférence, une organisation, une agence ou une révolution nous fournisse bientôt une vision cohérente de la société de l’avenir, accompagnée du plan d’ensemble des mesures à prendre au fil du prochain demie siècle pour mitiger les catastrophes.
Les auteurs du Pacte postulent que la seule manière de se mettre en route quand la destination est incertaine et que le chemin n’est pas tracé est de s’en remettre à chaque embranchement à une préférence systématique pour la branche qui nous éloigne des causes du problème. Il n’est pas nécessaire de savoir où mettre la main pour l’éloigner du feu. Il faut rapporter sur chaque carrefour et sur chaque décision, grande ou petite, privée ou publique, la distinction entre ce qui nous enferme dans le pétrole (et dans la pollution et la surconsommation) et ce qui nous en éloigne, et il faut faire descendre les grands arbitrages globaux, qui ne savent ni quels buts viser ni comment les viser, dans toutes les inflexions de la pratique où les choses bien concrètes qu’il faut éviter comme la peste se désignent à l’évidence. Un peu comme c’est le cas pour la puissance du « négatif » dans la dialectique du discours (mille occurrences positives ne prouvent pas l’hypothèse générale qui les attend, une seule occurrence négative la réfute), il est plus facile de s’entendre sur les choses particulières qu’il faut éviter que sur la constitution d’ensemble du monde dont on voudrait. De tels arbitrages négatifs, qui formeraient dans l’ensemble un processus itératif et réflexif, déboucheraient tout naturellement sur des hiérarchies pratiques et sur des choix de grande portée: on peut, sans contradiction, préférer qu’une mesure (une loi, une invention, une infrastructure, une campagne d’éducation, etc.) pousse la consommation vers A plutôt que vers B (vers une forme d’énergie plutôt que vers l’autre, disons), en adopter une autre qui favorise la réduction globale de ce type de consommation plutôt que de l’accroître et une autre encore qui redistribue fiscalement les coûts des changements sur les diverses catégories de revenus.
Les accords portant sur les choses à éviter ayant valeur en eux-mêmes, ils ne dépendraient que marginalement les uns des autres et absolument pas d’un plan d’ensemble. On pourrait y entrer en désordre ou en mosaïque et profiter des effets de combinaison inopinés. Cependant, aucun arbitrage sociétal de ce type ne pourrait être possible sans avoir force de loi et sans que ses conséquences sur l’inégalité sociale ne soit prises en charge par l’État. Quand vous dites que l’engagement d’un gouvernement à soumettre ses lois et ses décisions à ce double examen (écologique et fiscal) serait presque sans effet, je redoute que vous ne teniez pas compte de l’engagement lui-même, des attentes et des mobilisations qu’il susciterait et des effets d’apprentissage qu’il rendrait possible. A mesure que l’on s’engage plus profondément dans un cours d’action, on découvre simultanément les limites de cette action et la nature véritable de la «réalité» qui lui fait échec. Mais on découvre aussi les possibilités et les alternatives que cet engagement à ouvert, de même que la porte étroite vers où il faut faire porter ses espérances. Les mesures proposées par le Pacte seraient certes «insuffisantes» mais c’est précisément cette insuffisance qui nous ferait découvrir l’ampleur du problème.
C’est précisément là ce que vous essayez vous-même de nous faire comprendre, d’une manière admirable, avec acharnement et sans illusion, et il me semble que vous ne devriez pas négligez l’aide des signataires du Pacte.


 by
by 

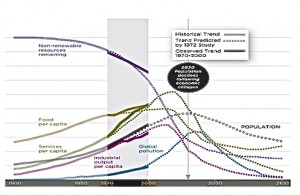


Quelques obstacles aux infléchissements d’un parcours déterminé, mais imprévisible.
Le premier tient à la nature même des propositions découlant du diagnostic que nous établissons, car elles ne sont finalement que des mots et des paroles pour parodier cette chanson de Dalida. C’est comme si vous et moi occupions le siège arrière d’un bolide propulsé de plus en plus vite, assis comme des enfants en bas âge dans un siège-jouet doté d’un similivolant, alors que le véritable conducteur fonce tête baissée, déjà sorti de chemins balisés, en route vers une destination inconnue. Nos admonestations demeurent pour lui des injonctions sans poids ni effets. Il devient illusoire dès ce moment de prétendre créer le chemin en le parcourant tandis que nous ne comptons pour presque rien dans les choix qui sont faits, peu importe les études réalisées, les livres publiés ou les pactes signés.
Le deuxième détermine en amont le premier… Et si la capacité de notre espèce d’anticiper le danger s’apparentait plus à celle de la grenouille de Rostand plongée dans une cuve d’eau qui s’échaufferait progressivement? Sébastien Bohler défend pourtant cette thèse dans un livre « Le bug humain » tout récemment publié, mais encore introuvable au Québec, dont parlait Isabelle Paré dans Le Devoir du 1er mars dernier, voir https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/548908/l-inaction-climatique-expliquee-par-un-neuroscientifique
Le troisième résulte des deux premiers. Nous sommes enfirouapés dans un écheveau de relations culturelles, économiques, sociales et politiques formant un système complexe d’où tout changement ne peut être anticipé de façon linéaire. C’est la théorie des catastrophes de René Thom qui en modéliserait sans doute le mieux le comportement. Or, les bifurcations qui s’annoncent n’ont rien de lisse, elles s’apparenteraient plus à des seuils plutôt douloureux.
Enfin, le dernier obstacle dont je n’arrive toujours pas à dessiner les contours réels concerne certains allèles culturels dans lesquels j’ai un peu naïvement placé mes espoirs. Je pense ici à ce modèle d’une économie sociale et solidaire qui viendrait remplacer l’économie prédatrice issue de ce capitalisme mondialisé (d’ailleurs ce changement demeure en soi tout un défi à relever!). À voir les acteurs de cette économie dite alternative évoluer, je ne peux être qu’affligé par la petitesse de certaines pratiques trop souvent dédiées à la poursuite de carrières minimisant l’audace au profit du maintien de privilèges. On se retrouve ici aussi enfermé dans cette « république des satisfaits » que Gilles Gagné a su si bien dénoncer. Mes arguments ne sont pas encore rendus péremptoires, mais ils ne font qu’accroître mes appréhensions initiales.
Pour moi, notre course s’apparente donc de plus en plus à celle de la reine rouge…
Remarque : la version en arbres morts du livre de Sébastien Bohler sera disponible au Québec en mars, selon le site de l’éditeur.
Apparemment, la version numérique est disponible :
https://www.epagine.fr/ebook/9782221241608-le-bug-humain-sebastien-bohler/
Merci beaucoup pour ce lien, j’avais tenté sur d’autres sites français, mais je recevais un message m’avisant que j’étais en dehors de la zone où l’achat par téléchargement était permise…
Vous les connaissez bien mieux que moi, mais j’ai consacré un chapitre du livre à l’échec du mouvement social, qui s’oriente, comme le mouvement environnemental (et aussi la société civile plus généralement), à des efforts maintenant dépassés à mieux orienter notre société capitaliste.
Réponse amicale à M. Gagné,
POUR UN PACTE ÉCOLOGIQUE CONCRET
Votre texte nous fait entendre comment l’urgence climatique mobilise la ferveur lorsqu’il est question de nos croyances fondamentales quant à l’instance tierce qui est l’État ainsi que les références des sociétés occidentales que sont la «Science» et le «Droit», où s’élaborent la raison et la rhétorique humaines depuis l’Antiquité. Comme vous, j’ai signé le Pacte pour la transition écologique dans les premières semaines avec mes 260,000 concitoyens, cherchant une issue à l’impasse actuelle. Cependant, je demeure dubitative comme M. Mead face à l’action de M. Dominic Champagne et les groupes environnementaux qui soutiennent sa cause en coulisse et à bas bruit.
Dans le contexte des diverses crises écologiques, économiques et sociales occidentales, le blogue de M. Mead s’est concentré surtout sur la crise énergétique et la perspective de l’effondrement de l’économie de marché actuel tel que prédit par le groupe Halte à la croissance dès 1970. Cette réflexion personnelle a fait l’objet d’un livre intitulé «Trop tard» qui s’adressait au grand public, mais surtout à ses collègues des groupes environnementaux québécois. Il les invitait à reconnaître que la vision des questions environnementales qu’ils ont soutenus pendant près de 30 ans et les actions prises pour contrer la destruction des écosystèmes québécois ont fait fausse route. Au Québec, la réflexion des groupes environnementaux n’a pas été au-delà de demander des mesures de protection de segments d’écosystèmes, de revendiquer l’investissement dans la techno-science verte et d’instaurer la politique des 3 R (réduire, réutiliser, recycler). En fait, il s’agissait d’une rhétorique inscrite dans les paramètres économiques occidentaux de la croissance industrielle qui subordonne les écosystèmes aux activités économiques. Cela expliquerait en partie pourquoi les bouleversements climatiques actuels nous apparaissent comme des événements que nous subissons d’une instance quasi-abstraite que serait «l’environnement», tout en nous abstenant de remettre en question notre mode de vie destructeur. Nous persistons à percevoir les écosystèmes terrestres à travers les visières du «scientisme» et de la gouvernance par les nombres. La «Science» érigée en référence serait censée nous apporter la solution technologique toute indiquée aux problèmes du vivant et le gouvernement par les nombres nous entraîne a fixer un objectif «abstrait» de réduction du Co 2 de 37,5% sous le seuil de 1990, comme limite mathématique à la pollution planétaire. C’est rechercher le remède là où origine la maladie.
Nos gouvernements tente de soumettre les systèmes écologiques, l’incalculable, à la Science et à l’économisme. Alors que les Sciences de la Terre, qui étudient notre habitat à travers les interactions des divers systèmes complexes non-linéaires et des seuils qui lui sont propres, nous démontre que la Terre ne peut pas être soumise à une telle gouvernance par la quantification mathématique et subordonnée au primat des activités économiques humaines. Nous pervertissons cette connaissance pour la soumettre au projet de prospérité économique en visant sa pérennité alors qu’elle menace la généalogie humaine. Telle est notre contradiction. Pour revenir à la raison, il nous faudrait reconnaître la Terre et ses écosystèmes comme «Référence» et y subordonner l’action humaine.
Le projet de loi issu du Pacte de transition écologique et soumis au gouvernement Legault demeure fidèle en cela à la dogmatique industrielle et au scientisme dont elle se soutient. Les actions engagées restent celles des groupes environnementaux depuis plusieurs décennies et qui se sont avérées caduques: pression publique par des pétitions, manifestations périodiques dans les rues, participation à des commissions consultatives.
Si le projet de loi prenait toute la mesure du défi que pose la crise climatique, il s’adresserait à la Cour supérieure du Québec afin que le gouvernement Legault reconnaisse le fleuve Saint-Laurent comme une personne juridique. Cela éviterait de devoir combattre, à la pièce, tous les projets industriels qui menacent le fleuve, comme c’est le cas actuellement.
C’est bien connu que le réchauffement climatique accentue les cycles de l’eau et il modifiera de manière irréversible l’écosystème dominant du Québec, avec ses 4,600 kilomètres de côtes. Si cette action juridique visant à protéger le fleuve, emblème du Québec, n’est pas entamée, ce cours d’eau majestueux transformera la vie de nombreux Québécois en réfugiés de l’intérieur. N’as-ton pas déjà commencé à déplacer les résidents de Sainte-Flavie, affectés par l’érosion, dans les rangs de l’arrière-pays? Et peut-être bientôt ce sera au tour des habitants des Îles-de la Madeleine? Nous sommes confrontés à rien de moins de faire en sorte que l’État assume la fonction première que les humains lui ont prêté il y a près de 800 ans, celle d’instituer la vie, de la protéger, afin que se perpétue les filiations humaines dans le respect de la Nature.
Pour nous aider à revoir nos rhétoriques :
Pierre Legendre: Le monument romano-canonique. Étude sur l’architecture dogmatique des sociétés, Paris, Fayard, 2009.
Pierre Legendre, Ce que l’occident ne voit pas de l’Occident, 2004
Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, Paris, Fayard, « Poids et mesures du monde », 512
Alain Supiot, Homo juridicus: essai sur la fonction anthropologique du droit, Paris, Éditions du Seuil, «La couleur des idées»,
Le site Resilience Alliance. Article: « A friend and a foe: Amid global environmental change, water becomes both the victim and the instigator for irreversible damage »
Voir site Internet: https://stockholmresilience.org/research/research-news/2019-01-14-a-friend-and-a-foe.html
Pouvez-vous préciser le sens que vous accordez à scientisme, SVP Mme Woods? Je n’ai trouvé que ceci (cherchant Supiot et scientisme):
Supiot explique que « […] depuis les années 1980, le scientisme a ressurgi avec la foi ultralibérale en un monde global régi par les lois immanentes de l’économie et peuplé de particules contractantes mues par le calcul de leurs utilités individuelles ».
Larousse écrit pour scientisme: opinion philosophique, de la fin du XIXe s., qui affirme que la science nous fait connaître la totalité des choses qui existent et que cette connaissance suffit à satisfaire toutes les aspirations humaines.
Mais quels scientifiques en 2019 affirme de telles conneries?
J’avance que Supiot confond scientisme avec économisme que Larousse définit ainsi: doctrine libérale qui a tendance à réduire l’individu à un Homo œconomicus pratiquant en toute situation un calcul coût/avantage dans ses choix politiques, familiaux, éducatifs.
Bonjour M. Lutz,
Tout d’abord, je tiens à dire que le travail intellectuel d’Alain Supiot sur l’anthropologie et le droit s’est élaborée sur plus 50 ans et ne peut se résumer à un court extrait provenant d’une source sur Internet, comme celui que vous citez.
Voici des éléments de réponse tirés de son libre, Homo Juridicus :
«Le scientisme advient lorsque, comme un fleuve en crue, la science sort de son lit. Quittant le terrain scientifique qui est celui du doute et où l’on sait devoir ne jamais trouver qu’une représentation provisoire et approximative d’une vérité pour toujours insaisissable, le scientisme répand sur le terrain de l’herméneutique de la vie humaine les certitudes d’une Science fétichisée (…) il est le fait de nombreux chercheurs en sciences sociales qui, aspirant à se fondre dans les sciences de la nature, s’acharnent à considérer l’homme exclusivement comme une chose. Qu’ils viennent des sciences dures ou des sciences molles, le scientisme se reconnaît à sa croyance que l’homme est un objet entièrement explicable et qu’il n’est rien à connaître de lui que les sciences de la nature ne doivent un jour nous révéler ou nous permettre de maîtriser.» p. 70
«… le scientisme se situe dans le droit-fil du montage anthropologique de l’Occident moderne qui perçoit l’Homme à la fois comme esprit capable de connaître et maîtriser l’ensemble des lois qui gouverne l’Univers et comme chose soumise à ses lois.»
«Dans un monde qui fait de la Science sa référence ultime, la croyance en la dignité de l’homme est reléguée dans la sphère privée au côté des religions, pour laisser place sur la sphère publique au seul «réalisme» de la lutte pour la vie. C’est alors ce réalisme supposé, ce scientisme, qui tient lieu de croyance et sur lequel on s’emploie à fonder l’ordre économique et social.» p.72 Ibidem.
L’économie néolibérale qui s’érige en Science économique, constitue de ce point de vue une fiction, une représentation du monde dont le paradigme axé sur la croissance économique et du PIB se présente comme une Vérité. Dans le sens contraire, le livre de M. Mead, « L’indice de progrès véritable du Québec, quand l’économie dépasse l’écologie» publié en 2011, remet en question les présupposés analytiques de l’économie néolibérale basée sur la croissance du PIB et qui exclut les externalités négatives générées par des activités économiques destructrices.
L’économie néolibérale peut alors être qualifié de fondamentalisme, en ce sens qu’elle s’est érigée comme fondement de nos sociétés industrielles, en remplacement des croyances religieuses qui ont été le fondement de l’Occident chrétien pendant plus de 2 mille ans. On croit à la toute-puissance du PIB,de la bourse, à la croissance infinie avec la même ferveur que nos ancêtres en Dieu tout puissant. Voila le scientisme.
Encore une fois, votre dernier paragraphe décrit exactement l’économisme, pas le scientisme. Pourquoi tordre le sens convenu des mots?
Si on est dans la merde actuellement ce n’est pas parce qu’on a trop écouté les scientifiques mais l’inverse! C’est parce qu’on a ignoré leurs avertissements!
Et lorsqu’une société entière réticente à repenser ses choix de vie vous répond devant la problématique de la raréfaction des ressources fossiles ou devant celle des changements climatiques :
«les scientifiques vont trouver une solution», «on va trouver une énergie propre», «on va faire du pétrole avec du plastique», «on va transformer le charbon en pétrole», «si ce n’était pas du lobby du pétrole, les énergies durables auraient réglé le problème», «la géo-ingénierie va régler le problème», «on n’aura qu’à enfouir les GES», «les plantes OGM vont capturer le carbone», etc, etc,etc
qu’est-ce que c’est si ce n’est pas une fois aveugle dans la science!!!???
(Et si par ailleurs vous croyez encore que les énergies «durables» vont tout solutionner – y compris la sixième extinction, la surpêche, la raréfaction des métaux, la dégradation des terres arables et la dissémination quasi ubiquitaire des toxines dans les milieux – et bien,je vous invite à faire une véritable pause dans votre preaching et à vous arrêter pour lire encore un peu plus.
une piste : https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/pourrions-nous-vivre-comme-aujourdhui-avec-juste-des-renouvelables/
Raymond Lutz va peut-être répondre lui-même, mais je ne vois aucun lien entre vos bouts de phrase entre guillemets et ce que Lutz a offert dans ses commentaires sur le blogue. Ces bouts de phrase font référence à des applications postulées de la science à la résolution des problèmes, et non à la science comme telle. La foi dans la technologie constitue un autre -isme…
Il y a ceux qui fabriquent et transmettent les connaissances techno-scientifiques (chercheurs, ingénieurs, enseignants) et il y a ceux qui les vendent (et tentent de s’enrichir, quitte à mentir).
Une foi aveugle dans la science? Ne confondez pas le baratin du vendeur avec celui de l’ouvrier ou du mécanicien.
Non, je ne crois pas que les ER vont tout solutionner (au contraire): la survie de l’Homo Sapiens Sapiens passera par un retour forcé à la paysannerie et à l’artisanat (production low-tech non-industrielle, inefficace mais pérenne).
Si j’avais les ressources, je démarrerais un centre de recherche agraire en traction équestre (et visiterais Cuba pour m’inspirer de leurs expériences en permaculture).
https://pinboard.in/u:lutzray/t:equestre/
Oh, et « Don’t let the Nobel prize fool you. Economics is not a science » [1]. J’aurais dû écrire: « Si on est dans la merde actuellement c’est parce qu’on a ignoré les avertissemsnts des biologistes, des chimistes et des physiciens ».
PS: Désolé pour ces distinguos qui apportent peu au sujet principal, je le reconnais.
[1] https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/oct/11/nobel-prize-economics-not-science-hubris-disaster
Nonobstant le scientisme, il est utile d’ajouter à notre compréhension l’éclairage apporté par les neurosciences. À cet égard, je ne saurais que vous recommander la lecture du livre de Sébastien Bohler, « Le bug humain » où malgré quelques réserves que je porte à son interprétation (entre autres sur le circuit de la récompense affectant le statut social au lieu de valeur des relations sociales) mérite d’être lu pour prendre en considération non seulement l’impotence de notre mésencéphale dans l’appréciation des dangers contemporains, mais surtoute des effets systémiques que cette lacune engendre.
Merci M. Cotnoir mais je n’ai plus le temps de lire des bouquins (désolé pour tout le monde! pour vos livres, M. Mead et pour les références données par Mme Woods). J’ai 95 étudiants de physique au collégial, j’ai trois enfants au primaire+secondaire et je suis aspiré par la crise sociale et politique en France (et par la présidentielle qui se prépare aux USA). Emporté par le maelstrom informationnel, je lis sur le net ici et là et je crois reconnaître dans vos propos sur Bohler des mécanismes cognitifs (fautifs) décrit dans « This Article Won’t Change Your Mind – The Atlantic ».
Sans fausse honte, je recopie un de mes tweets: « I don’t believe anymore good arguments can change something in people’s head. I don’t believe anymore in Rationality as a driving social force. We’re hardwired to hang to our misconceptions. See this Atlantic article for a starter: “Having social support, from an evolutionary standpoint, is far more important than knowing the truth.” Pascal Boyer
Il est plus le temps d’agir que de s’instruire (personnellement). Remarquez que d’instruire les autres est en soi une action
[1] https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/03/this-article-wont-change-your-mind/519093/